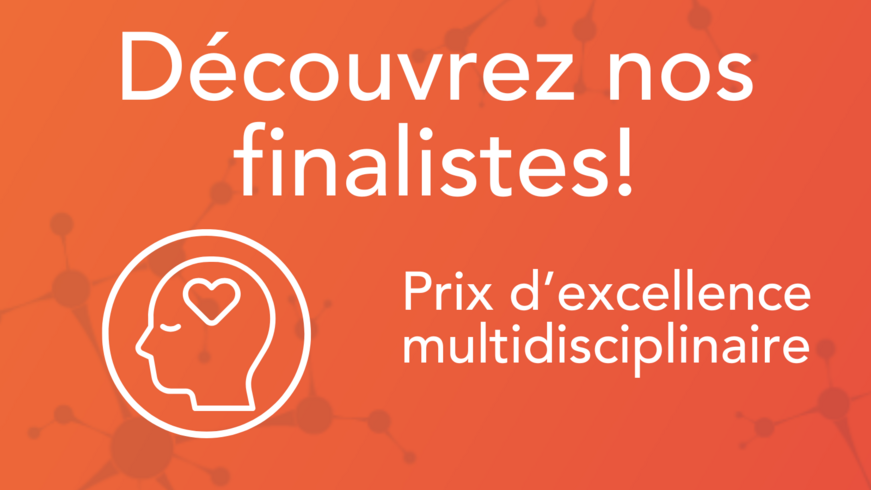Créer un espace de discussion adapté sur la toxicomanie en psychiatrie légale : une initiative axée sur l’ouverture et la réduction des méfaits
Depuis son ouverture au printemps 2019, l’unité de psychiatrie légale a accueilli des usagers présentant des problématiques de concomitance complexes, où la toxicomanie constitue un facteur significatif de risque de violence ou de récidive criminelle. Malgré l’importance de cet enjeu, la majorité des usagers ne sont pas admissibles à des suivis individuels spécialisés en dépendance. Les raisons incluent une absence d’autocritique, un manque de connaissances de base sur la toxicomanie et une faible motivation à modifier leurs habitudes de consommation.
Ces défis sont exacerbés par des profils de personnalité complexes (antisocial, narcissique, cluster B, etc.) et des restrictions légales, telles que l’interdiction de consommer ou des limites pour les sorties hors de l’unité. Ces contraintes ont un impact négatif sur la construction de l’alliance thérapeutique entre les usagers et les équipes traitantes. Par conséquent, les tentatives d’implanter des thérapies structurées existantes se sont avérées inefficaces, révélant le besoin d’une approche spécifique et adaptée à cette clientèle unique.
L’objectif principal de cette initiative est de concevoir un groupe de discussion thérapeutique sur la toxicomanie, spécifiquement adapté aux besoins cognitifs, motivationnels et légaux des usagers en psychiatrie légale. Intitulé « Groupe de discussion sur la consommation », ce programme se distingue par sa flexibilité et son approche basée sur la réduction des méfaits. Le programme est composé de deux volets : comprendre la toxicomanie (15 séances) et stimuler le changement (20 séances). Chaque séance vise des objectifs spécifiques et intègre des outils interactifs pour favoriser l’apprentissage et les échanges.
La participation élevée et l’engagement croissant des usagers ont contribué à l’efficacité du programme. Les usagers, initialement réticents ou en retrait, deviennent progressivement plus actifs dans les discussions, grâce au format informel et libre de jugement. De plus, les discussions thématiques permettent un apprentissage mutuel; elles favorisent une dynamique positive entre participants, même lors de sujets délicats. Au fil des séances, les usagers développent une meilleure compréhension de leur consommation, ce qui favorise une introspection et une prise de conscience utiles pour leur réadaptation.
Le Groupe de discussion sur la consommation constitue aussi une porte d’entrée pour identifier les besoins spécifiques des usagers. Les participants qui démontrent une motivation accrue ou des besoins spécifiques peuvent être dirigés vers des programmes plus poussés en collaboration avec le Centre de réadaptation en dépendance (CRDM). Enfin, le programme s’inscrit dans une démarche évolutive : il s’appuie sur une rétroaction continue des participants, recueillie par le biais de formulaires d’appréciation. Ces retours permettent d’ajuster dynamiquement le contenu et l’animation des séances pour répondre aux besoins des usagers.
En résumé, le Groupe de discussion sur la consommation crée un espace sécuritaire et adapté, où les usagers peuvent non seulement enrichir leurs connaissances sur la toxicomanie, mais aussi amorcer un processus de changement motivé et soutenu. Ce projet novateur démontre que l’adaptation des pratiques aux spécificités des usagers peut transformer des défis complexes en opportunités de rétablissement.
Nos professionnels en actions
Membres de l’équipe
- Sophie Mongeon, travailleuse sociale
- Christine Yacoub, psychoéducatrice et SAC
- Jeanne-Marie Allard, cheffe de service
Aux fins de ce projet, Sophie Mongeon, travailleuse sociale, assure la responsabilité du développement conceptuel et du contenu, comprenant l'élaboration des outils d'animation ainsi que la conception des cahiers destinés aux participants et aux animateurs, en plus de superviser l'animation des groupes. Pour sa part, Christine Yacoub, psychoéducatrice, est en charge de la mise en page et de la présentation du contenu, incluant les cahiers des participants et des animateurs, les outils d'animation ainsi que les références bibliographiques.